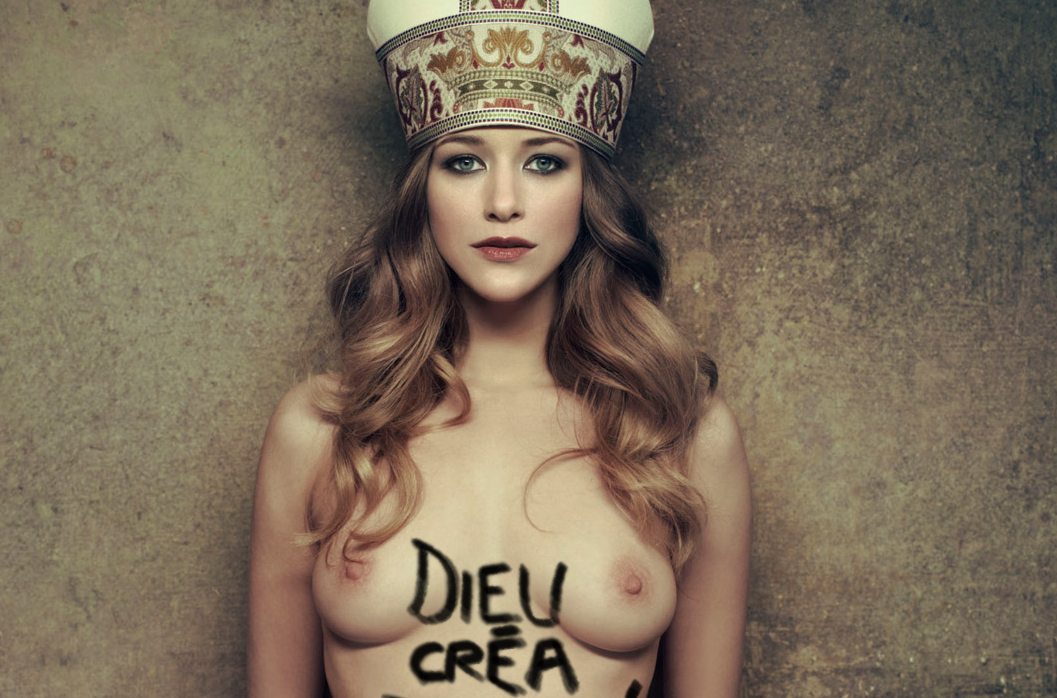Diana Vreeland: du Bazar au musée (The eye has to Travel)
De ses débuts comme chroniqueuse pour le Harper’s Bazaar à ses années en tant que rédactrice en chef du magazine Vogue, Diana Vreeland à révolutionner la mode. Intitulé The Eye has to Travel, le documentaire qui retrace l’histoire de sa vie est actuellement en salle dans quelques cinémas parisiens. Retour sur le phénomène Vreeland.
Née à la belle époque –en 1903 à Paris- Diana Dalziel de son nom de jeune fille a été bercé depuis l’enfance dans l’univers de la mode. Entre son père banquier et homme du monde, et sa mère, une très belle américaine qui chassait le rhinocéros en Afrique, elle n’avait pas le choix, elle se devait de réussir. Pourtant, dans sa jeunesse son physique atypique lui a attiré assez naturellement, le rejet maternelle. De se traumatisme, elle en a gardé un désir intense d’affirmer sa différence à travers son travail et sa vision du monde.
Comme beaucoup de jeunes filles de bonnes familles à cette époque, Diana Vreeland s’est rapidement bien marié. Son statut de simple épouse de notable lui permis d’assurer le train de vie auquel elle prétendait. Seulement, très vite, la routine s’est installée dans se vie. Alors, elle s’est plongée dans les années folles, dansé à Harlem, s’est mariée avec un certain Reed Vreeland à la terrassante beauté et, bien que «très paresseuse», a commencé à travailler sur une proposition de la patronne de Harper’s Bazaar à l’âge de 33 ans.
D’abord propriétaire éphémère d’une boutique de lingerie, Carmel Snow, la rédactrice en chef de Haper’s Bazaar, l’a contacté pour réaliser des chroniques de mode dans son magazine. Après l’avoir vue danser à l’hôtel Saint Regis, à New York un soir, Carmel Snow était envoutée par l’élegance de Diana Vreeland. Sa toilette –du Coco Channel- était à l’époque se qui se faisait de plus raffiné.
L’ascension de la chroniqueuse
intitulée «Why don’t you…», sa chronique où ses suggestions du moment («Pourquoi ne pas… laver les cheveux blonds de vos enfants au champagne pour qu’ils restent dorés ?») a largement contrasté avec le climat économique, lui attirant un fan-club dévoué, la mode étant un théâtre où l’absurde s’applaudit plus qu’ailleurs (et n’est-ce d’ailleurs pas sa plus grande qualité ?).
Intérrogée au sujet de l’apport de Diana Vreeland à l’univers de la mode lors de ses années de chroniques, la réalisatrice du documentaire explique et retrace avec precision ce que la papesse de la mode a fait pendant ces années comme chroniqueuse.
“Elle a émancipé les femmes. Anjelica Huston dit, dans le documentaire, que Diana a déterminé la ligne éditoriale du magazine, mais aussi la mode de l’époque. Elle a popularisé le blue-jean et, après la guerre, en 1946, elle a fait la promotion du premier Bikini! L’Amérique n’était pas prête et la rédaction était effarée par les photos de ces mannequins si dénudés! Diana Vreeland a aussi été une découvreuse de talents: elle a repéréLauren Bacall dans la rue et lui a demandé de devenir mannequin pour Bazaar. En 1943, elle l’a poussée en couverture, c’est là qu’elle a été remarquée par Hollywood. De la même manière, Diana a propulsé dans le cinéma Lauren Hutton, Anjelica Huston, Marisa Berenson…
Elle a également lancé de grands photographes comme David Bailey ou Richard Avedon, qui l’ont suivie quand elle est devenue rédactrice en chef à Vogue, en 1962…
Avedon raconte que Diana recommandait d’accentuer les défauts des mannequins: les dents du bonheur de Lauren Hutton, le profil Barbra Streisand avec son nez à la Nefertiti. Elle a sublimé la gracilité de Twiggy, l’androgynie de Cher, le côté sauvage de Veruschka… Grâce à Diana Vreeland, les mannequins devenaient des personnalités. Et les personnalités posaient comme des mannequins! Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor, Mia Farrow et bien d’autres ont fait des séries de mode pour elle. “
L’explosion des sixties
En Arrivant chez Vogue, Diana Vreeland était déjà une icône de la mode. Mais toujours captivée par le désir de surprendre, elle a fait du magazine un peu trop conventionnel de l’époque, un phénomène de société grâce à des photos d’un genre nouveau. Avant elle, personne n’avait osé sublimer les mannequins en les incorporant aux décors des shooting. Mais le budget n’étant pas une contrainte à l’époque, la rédactrice en chef a organisé des séances photos partout à travers le monde. Aucun rédacteur avant elle n’avait eu l’idée de faire jouer les mannequins le rôle de personnages historiques tels que Cléopatre au milieu des ruines de palais égyptiens. Elle n’a d’ailleurs jamais hésité à repousser les limites de la création. Faire poser des modèles sur le toit d’une en Iran, seule elle pouvait avoir ce genre d’idées. Son concept c’était que « l’oeil doit vagabonder.«
Diana consacrait énormément de place dans les pages de Vogue aux artistes et aux intellectuels. Elle a par exemple demandé à Marguerite Duras d’écrire un article au sujet de Brigitte Bardot… L’édition américaine du magazine a même publié, en 1964, la première photo de Mick Jagger, « un inconnu » que le Vogue britannique avait snobé.
L’effervence des sixties correspond au moment où l’essor économique d’une industrie a rencontré une pop culture en plein boum (avant de finir par la cannibaliser, quelques décennies plus tard), et où il semblait tout naturel d’irriguer une série photo de références au Dit du Genji.
Quand en 1972, la direction de Vogue l’a licencié à cause de ses dépenses exorbitantes, Diana Vreeland est terrassée. Sa vie sans Vogue, sans son statut de rédactrice tyranique et charismatique lui semble fade et indigne d’intérêt.
De la disette éphémère au musée éternel
Élève du monde et d’Oscar Wild, Mrs. V -comme on l’appelait- a fait du métier de rédactrice en chef de Vogue un personnage à part entière. Elle a inspiré des générations de femmes faussement autoritaires -de Carine Roitfeld à Anna Wintour- en apportant à la fonction de directrice du magazine un éternel personnage de tyran adulé. Logiquement après son renvoi, elle n’est pas resté longtemps sans emploi. Diana Vreeland a directement été contactée par le Costume Institute du Metropolitan Museum de New York, où elle a monté de flamboyants shows sur l’histoire de la mode en se souciant le moins possible de la véracité historique. Faire d’une institution un phénomène de mode… C’est un peu ce qu’elle a fait toute sa vie.
Un documentaire à son image
Le film s’arrête là où il a commencé: dans le salon rouge sang de Mrs. V, embrumé de fumée et avec un Yves Saint Laurent, passant sous silence ses dernières années. Devenue aveugle («d’avoir vu tant de belles choses», disait-elle), Vreeland est resté confinée dans son appartement de Park Avenue, y recevant Oscar de la Renta, André Leon Talley et Jacqueline Onassis, qui se sont succédés pour lui faire la lecture. À la toute fin, elle refusait même de sortir de sa chambre, exigeant également de recevoir à dîner ses amis. Elle a fait installer un téléphone dans la salle à manger, pour deviser avec ses hôtes depuis son lit. Elle qui disait «détester la nostalgie» ne peut s’empêcher ici de la provoquer.
Sans Diana Vreeland, le film n’est rien. Son charisme débordant, son visage si particulier aux traits appuyés, au nez masculin, coiffé d’un brushing casque couleur jais, son maquillage à la manière des acteurs de kabuki (qu’elle trouvait «so chic !»), a fini par devenir une silhouette inimitable mais reproductible en trois traits de crayons. À côté d’elle, les autres intervenants du documentaire paraissent fades, sans saveurs. Tous sont gommés un par un, comme écrasés par le personnage Vreeland.
Alors forcement, le film vit et meurt par Diana. Les parties sans ses légendaires répliques sont d’un ennui mortel. Le montage est propre et simpliste, mais au final, il ne fait que reprendre les codes de l’ex rédactrice en chef de Vogue. En fait, pour aimer le film, il faut aimer Diana Vreeland, c’est aussi simple que ça. Rarement un film, une histoire, aura été aussi dépendante de sa star. Mais n’est pas Diana Vreeland qui veut. Elle disait « pour être quelqu’un, il faut se démarquer des autres. » Toute sa vie elle s’y sera tenue.
__________________________
DIANA VREELAND : THE EYE HAS TO TRAVEL de LISA IMMORDINO VREELAND avec Bent Jorgen Perlmutt, Frederic Tcheng… 1 h 25.